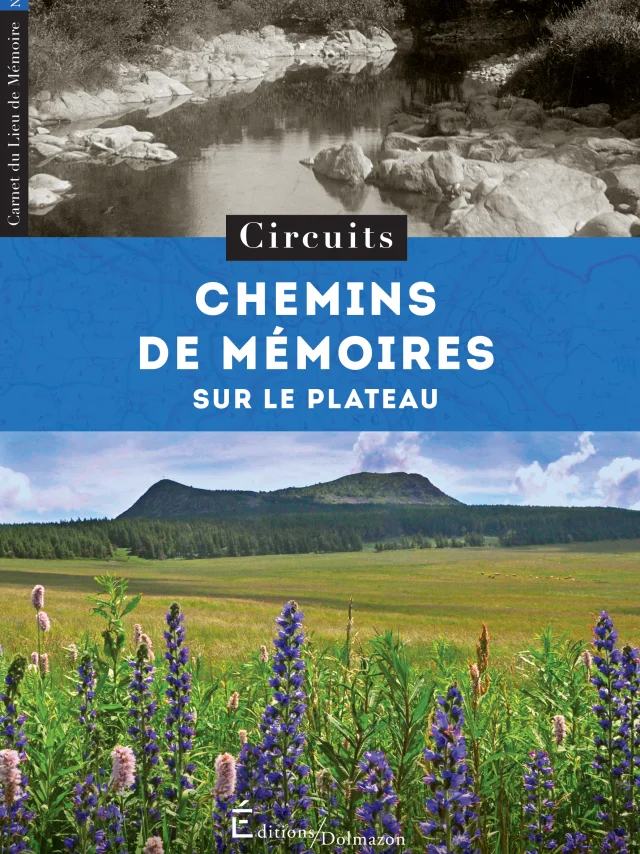Convertis à la réforme vers 1560, dans le sillage des prêtres, des hobereaux de campagne, des colporteurs vaudois, les huguenots de la Montagne ont vécu de difficiles et parfois de terribles épreuves au XVIII siècle : abjurations forcées, dragonnades, amendes, arrestations et condamnations aux galères ou au « brevet de potence ». Ces drames se sont alors inscrits dans la mémoire collective et ont suscité une solidarité à la fois sociale et religieuse qui existe encore de nos jours.
Au temps de la Révolution de 1789, les prêtres réfractaires à la Constitution civile du clergé trouvent ici des « caches secrètes » mises en place par des familles protestantes, leur offrant ainsi un abri contre les persécutions.
Si la Montagne s’identifie par sa façon de croire, on remarque une forte endogamie géographique concernant les mariages, entre « gens du pays » et surtout en fonction d’une contrainte collective d’essence religieuse, pas ou peu de mariages mixtes. La Bible est aussi un réservoir inépuisable de prénoms, Abel, David, Samuel côtoient Rachel, Sarah et Esther !
Le besoin de s’instruire, l’impatience de lire, le souci de l’information, l’esprit de progrès et le souci de moralité caractérisent les gens du Plateau. A trop considérer la Réforme comme un événement purement religieux et politique, on sous-estime la mutation socio-culturelle qu’elle représente dans les campagnes de la Haute-Loire orientale.
Aujourd’hui la palette des communautés protestantes du Plateau est extrêmement large, peut-être unique en France ! Choquante ou nuisible à l‘unité pour certains, ce foisonnement du protestantisme constitue une réelle vitalité et une grande liberté.
 Interieurtemplemazetcopyrightamelie
Interieurtemplemazetcopyrightamelie- Implantation des églises dites « libres »
- C’est le mouvement darbyste et les Assemblées puis des scissions au sein du darbysme avec l’apparition des Frères étroits ou Ravinistes qui vont encore se diviser.
- Implantation forte de l'Armée du Salut.
- Mouvement Pentecôtiste
- Assemblée évangélique du lieu-dit Malagayte